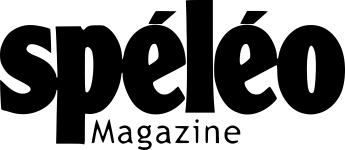Spéléo magazine 91
J’apprends que le thème principal des Rencontres d’Octobre (cf. page 5) est consacré à la présence du CO2 dans le milieu souterrain. Je ne peux pas m’empêcher de me souvenir d’une exploration des plus éprouvantes pour moi, dans les Salles Rouges de l’aven d’Orgnac (cf Spéléo Mag n° 90). C’était l’année dernière…
J’arrive au petit matin, de Grenoble. Personne sur le lieu de rendez-vous. L’ambiance est automnale, froide et humide. Soudain, j’aperçois courir deux spéléos. Ils disparaissent Je m’approche. C’est Stéphane et Raphaël. La pompe qui désamorce le siphon et ouvre l’accès aux Salles Rouges est en panne. Redémarrage de celle-ci. Ouf ! La tension baisse. Ils vont pouvoir me briefer. Le taux de CO2 présent s’élève à 5,5 %. Cela demande une pratique particulière : ne surtout jamais s’affoler quand le manque d’oxygène se fait sentir. Facile à dire ! Raphaël m’accompagnera tout le long de l’exploration. Il sera mon ange gardien. Nous nous équipons d’une salopette néoprène. L’ascenseur nous mène directement à –100 m. Le ronronnement des pompes se fait entendre. Nous progressons lentement, et nous voilà devant le siphon désamorcé. Nous échangeons avec les spéléos en vigilance devant les pompes. Nous arrivons dans la salle du Siphon. Nous dégoulinons littéralement de boue liquide. J’ai le souffle court mais pas de gène particulière. Raphaël doit organiser les tuyaux d’évacuation dans le siphon. Je reste seul. Je commence les photos. Je suis venu pour cela. C’est ma contribution à l’expédition. J’installe mes flashs. Clic clac. Je déplace mes éclairages. Clic clac. Soudain, je ne respire plus. Surtout ne pas paniquer. Se remémorer les consignes. Je m’effondre sur le banc. Je cherche désespérément de l’air. Je me plie en deux. Réfléchir. Envie d’arracher mes vêtements, être torse nu, respirer, respirer… Sortir de ce piège à rat. J’ai toujours le souffle court. L’angoisse m’envahit. Rester calme, me maîtriser. Chercher le peu d’oxygène présent dans ces lieux. Poursuivre ma tâche. De longues minutes s’écoulent. Je reprends peu à peu mes esprits. J’ai dompté l’angoisse qui m’envahissait à la limite de la perte de contrôle. Ressenti, si près une forme de psychose m’envelopper. De nouveau lucide, je comprends mon état. Je me suis déplacé pour installer mes éclairages comme dans les massifs alpins ? Erreur ! Dans ces lieux, l’éloge de la lenteur est une véritable qualité. Raphaël revient. J’explique brièvement ce que je viens de vivre. Il ne me lâchera plus. Avancer de 10 m, se poser 10 minutes. Se concentrer. Une étroiture ascendante. La franchir le plus sereinement possible. S’écrouler après. Ne pas perdre son souffle. Le reprendre. Encore 5 m à monter. Pause. Enfin, nous sommes à la base de la cheminée du Parapluie (E 94 m). Je ferai la photo assis dans la boue, le pied photo entre les jambes, le souffle court, épuisé… à admirer Raphaël installer mes éclairages. TPST : 5 heures éprouvantes…
Serge Caillault